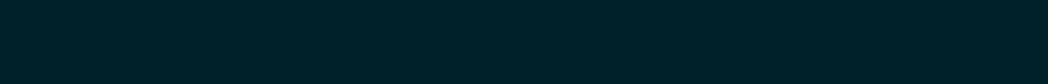Flashscore News : la première question est limpide, comment un Brésilien se retrouve-t-il sur le Tour de France ?
Mauro Ribeiro : je suis né à Curitiba, dans le sud du Brésil à 400 kilomètres de Sao Paulo. C'est une ville très européenne avec de nombreux immigrés espagnols et italiens et il y avait une belle culture du vélo. J'ai commencé par hasard et au bout de 3 ans, je suis devenu champion du monde juniors à Florence. Ça m'a permis de signer l'ACBB, un club qui a sorti de très grands champions comme Stephen Roche, Sean Kelly, Phil Anderson, Allan Peiper. J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1986 chez RMO où je suis resté jusqu'en 1992. J'ai roulé ensuite chez Chazal (1993), Lotto (1994) puis j'ai terminé chez Specialized America pendant 2 ans avant d'arrêter. Je voulais connaître le monde du vélo et découvrir l'Europe et j'ai pu tout faire ensemble. À l'époque, je ne mesurais pas l'importance d'avoir remporté un étape du Tour de France mais, avec le recul, je me rends compte que c'est grandiose, que ça marque une carrière. C'est une fierté d'avoir pu m'épanouir dans un sport si compétitif. À Rennes, j'ai battu Laurent Jalabert, c'était un très beau moment.
Les années 1980 ont été marquées par l'arrivée du cyclisme sud-américain dans les pelotons professionnels européens, notamment avec les coureurs colombiens.
J'ai fait partie de cette génération de "gitans", arrivée en France avec un sac à dos à un moment où le cyclisme se modernisait et démarrait sa globalisation. À l'époque, il y avait un Mexicain, les Colombiens, avec une manière différente car ils avaient déjà leur propre identité. C'était différent d'autres étrangers comme Phil Anderson ou Allan Peiper qui venaient d'Australie et qui étaient des pionniers comme Greg LeMond et Jonathan Boyer aux États-Unis. Je suis arrivé à cette transition avec le cyclisme européen pur et l'arrivée de nationalités exotiques. On peut voir ça comme une équation : ce que le Tour nous a apporté et ce que nous avons apporté au Tour. Symboliquement, ma victoire a été importante car elle a contribué à cette mondialisation.
Il était possible de voir le Tour de France dans les années 70-80 au Brésil ?
Il y avait la passion locale pour ceux qui pratiquaient. Mais à la télévision, je voyais une image ou deux, 30-40 secondes. Par rapport à l'espace accordé au sport par les télévisions... Il y avait la passion des familles d'origine européenne qui savait ce qu'était le Tour de France et la transmettait. Nous étions plus fermés, nous sortions de la dictature. Dans les années 1984-1985-1986, il y a eu des ouvertures mais, quand j'ai débuté ma carrière professionnelle, c'étaient deux mondes différents entre l'Amérique latine et l'Europe. Aujourd'hui, on est plus globalisé et un Brésilien peut maintenant voir 4 heures de vélo à la télévision si ça lui plaît, quelque chose d'impensable avant. C'était la passion individuelle avant tout.
Suite à votre victoire, le 14 juillet 1991, y a-t-il eu un effet de mode au Brésil ou cela a été sans lendemain ?
Ce succès a été important, j'ai été reçu par le président de la République. Aujourd'hui, je suis plus connu qu'à l'époque où c'était seulement des pratiquants. Le vélo s'est développé au Brésil en ce qui concerne le côté qualité de vie et bien-être. Au niveau compétitif, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes économiques et le vélo, sans être élitiste, est devenu très cher pour pratiquer à haut niveau. Le vélo, c'est devenu glamour, il faut montrer ses parcours, ses performances. Après ma carrière, j'ai pu me permettre de créer une marque, avec des vêtements, au point qu'on est devenu la référence en la matière au Brésil. J'ai pu le faire grâce à ma notoriété sur le vélo. Comme je suis proche de ce quotidien, même en Europe, je suis respecté car j'ai fait des choses pour le vélo.
Ce projet de marque est apparu à quel moment ?
J'ai arrêté ma carrière en 1998 et j'ai créé ma société en 2002. J'ai été sélectionneur national pendant 3 ans donc j'ai fait trois Mondiaux et les JO d'Athènes puis de Pékin comme conseiller technique. Sur le terrain, j'avais apporté mon expérience et mon vécu : j'ai voulu perpétuer ça, en apportant la connaissance européenne dans mes produits. C'est nous qui apportons cette diversité de produits au Brésil et on est reconnu pour notre identité née de cette victoire sur le Tour.
Votre victoire a-t-elle était un aboutissement dans votre carrière ?
La veille, nous avions tous eu une grosse défaillance sur le contre-la-montre. À l'époque, il s'agissait d'étapes très difficiles, 70 kilomètres. Le lendemain je me suis échappé et je me sentais très très bien. Deux jours plus tôt, j'étais dans l'échappée qui a été reprise à 250 mètres de l'arrivée et Jean-Paul Van Poppel avait gagné. J'avais de très bonnes sensations. Quand on est entré dans Rennes, j'ai parlé avec Christian Rumeur, le directeur sportif qui était venu à ma hauteur. Je lui ai dit que j'allais attaquer à 700-800 mètres de la ligne parce qu'avec Laurent Jalabert, Dimitri Konyshev, Guido Bontempi, j'aurais eu moins de chance au sprint. À 3 kilomètres de l'arrivée, Johann Bruyneel est sorti. Les Toshiba ont fait un gros effort pour aller le récupérer et il a été repris à 750 mètres. C'était le moment idéal pour attaquer. À 100 mètres, j'avais des crampes, j'étais au bout de mes forces. J'étais à 65km/h et je voyais que ça se rapprochait. J'ai gagné et j'ai battu Jalabert pour 27 centimètres ! J'ai la photo-finish à la maison !
Dans le même style que Victor Lafay à San Sebastián !
J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait parce que c'était le 2e jour et qu'il avait tout un peloton à ses trousses !
Depuis vous, seul Murilho Fischer a eu une carrière européenne, notamment à la Française des Jeux.
Murilho est toujours proche de la France et il est ambassadeur du Tour de France. Il a appris en Italie avant de venir en France. On a travaillé ensemble l'année où il fait 5e du Mondial à Madrid. On a eu un bon parcours et on a un vrai lien d'amitié. Il a eu une très belle carrière. C'est un Monsieur, c'était quelqu'un sur le vélo mais aussi en dehors.
Existe-t-il un espoir de voir bientôt arriver un Brésilien pour gagner de grandes courses, notamment par un système de formation ?
La distance que l'on pouvait éprouver à mon époque existe moins à présent. Quand j'appelais chez moi, la minute de téléphone coûtait 10 dollars ! Mais ce n'est pas moins difficile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec toutes les données disponibles, on voit très tôt si un coureur aura le potentiel suffisant. En plus, au Brésil, le système de formation est loin d'être une réalité. A l'heure actuelle, il y a Vinicius Rangel qui court chez Movistar et fait son chemin. Mais si je compare à l'école colombienne, et même si je ne veux pas critiquer le travail de la fédération brésilienne, on en est très loin. Pour moi qui ai vécu près de 15 ans en France, où il y a une orientation vers le sport-études, je constate que le Brésil est très grand mais chaque région a des comportements différents. Il y a de quoi faire car il y a beaucoup de potentiel et donc beaucoup de potentiels champions. Or il n'y a pas ce travail au quotidien.
Vous avez passé 7 saisons chez RMO et côtoyé ce qui se faisait de mieux en France. Vous étiez proche de Charly Mottet notamment.
Quand Charly est arrivé en provenance de Système U, nous avions déjà une grosse équipe. Mottet était notre leader mais il y avait aussi les frères Madiot, Thierry Claveyrolat, Eric Caritou entre autres. De sacrés coursiers ! Au terme de la 1re saison de Charly, nous étions la deuxième équipe mondiale et lui était numéro 1 mondial. Il n'était peut-être pas le plus médiatique mais il était très efficace sur le vélo. Il gagnait beaucoup de courses et avait une force mentale très importante. J'ai pu partager cette façon de courir avec lui. Nous avions un lien d'amitié et on partageait ça sur le vélo. Quand il gagnait les 4 jours de Dunkerque ou le Dauphiné, il pouvait compter sur moi pour tirer des bouts droits. On était toujours là à se motiver et aussi à partager les moments difficiles. C'était pareil avec Marc Madiot. Il a gagné Paris-Roubaix avec nous et j'étais le dernier coureur à lui remonter les bidons et il l'a reconnu. Ça forge une amitié. Tout ce parcours m'a fait grandir. J'avais aussi de bonnes relations avec les Italiens, avec Miguel Indurain. Ça m'a fait devenir un citoyen du monde.
Pour en revenir à Charly Mottet, beaucoup de suiveurs considèrent qu'il était trop honnête et qu'avoir été un coureur propre l'a privé d'un meilleur palmarès.
Pour avoir eu la chance de partager notre quotidien quelques années avec lui, il avait cette mentalité spéciale. On était à table, on discutait et il m'a dit : "tu sais, le vélo est un sport où il n'y pas besoin de beaucoup parler, les jambes parlent pour toi". Charly savait perdre, il connaissait ses limites mais il avait son identité, sa façon de courir. Quand il n'était pas bien, il était capable de nous dire de faire notre course, sans penser à lui. Il était très clean dans sa façon de voir les choses, il ne se préoccupait pas beaucoup de ce qu'on pouvait dire de lui. Il se remettait d'abord en question lui-même avant de regarder les autres. Il a été numéro 1 mondial deux années de suite, il a gagné de sacrées courses. Mais il lui a peut-être manqué une forme de spontanéité, comme pouvait l'avoir Richard Virenque. Quand Richard est arrivé, il disait qu'il voulait faire pleurer les Français ! Lui, il voulait passer à la télé, c'était volontaire, il voulait être une star. Charly voulait simplement faire son métier de manière exemplaire. Mais pour moi, Mottet fait partie de l'Histoire cycliste de la France.
Les liens au sein de RMO étaient solides, on s'en est aperçu en 1989 lors des Mondiaux à Chambéry. Thierry Claveyrolat est devant, il peut gagner mais Laurent Fignon veut rentrer, ce qui ulcère Mottet. Fignon attaque, revient sur l'échappée mais remet en jeu Greg LeMond qui devient champion du monde. On dit que Claveyrolat n'a plus jamais été le même après cette trahison, c'est vrai ?
Thierry marchait très bien, c'était une très grande année pour lui. Charly voulait que la course finisse comme ça parce que Claveyrolat était le plus fort. Quand Fignon est rentré, ça lui a mis un coup au moral, ça l'a mis en difficulté. Si Fignon n'attaque pas, personne ne revient.
Vous évoquiez Richard Virenque. Dès son premier Tour de France, il s'empare du Maillot Jaune après la 3e étape et c'est le début d'une grande amour avec le public français qui, malgré l'affaire Festina, ne s'est jamais étiolée. Comment expliquez-vous ce truc en plus qu'il a toujours eu ?
Quand il est arrivé chez RMO, il avait ce caractère de baroudeur, cette agressivité. C'était le jeune qui voulait réussir. Physiquement, il était très costaud. Il était fou-fou mais il transmettait de l'énergie. Les plus anciens ont dû le cadrer, lui expliquer qu'il devait y aller pas à pas. Je me rappelle d'un camp d'entraînement, la dernière montée était escaladée à un rythme très rapide mais lui voulait aller encore plus vite... mais il est arrivé trois ou quatre minutes après nous. Le soir, Charly a mis un trophée à sa place en disant qu'il était le champion de l'entraînement et il a dit à Richard qu'on était tous dans la même équipe et qu'on était ensemble. Si tu es le plus costaud, tu dois aider le plus faible de l'équipe et la compétition, c'est avec nos adversaires pas avec nos coéquipiers. Quand tu es le plus fort, aucun besoin de le montrer. Ce jour-là, Richard a compris quelque chose. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il était très sympathique, très vivant. Il était ambitieux, oui, mais si tu ne l'es pas, tu n'as pas envie de réussir, surtout dans le cyclisme. Il y avait Bruno Roussel dans l'encadrement et c'était quelqu'un de très volontaire aussi. Mais par la suite, ils ont peut-être changé de vision, il y avait aussi un aspect business, la notoriété. Richard était spontané, dans sa manière de parler, des gestes, sa naïveté parfois. Cela a créé un lien avec le public.
Cela allait même jusqu'à Nicolas Sarkozy. Quand on les voyait ensemble, on ne savait pas qui était le plus fier des deux : le cycliste qui rencontrait le Président de la République ou le Président de la République qui rencontrait le cycliste !
Richard dégage beaucoup d'énergie positive. La France est une société très évoluée, qui se pose beaucoup de questions mais lui, il mettait ça de côté. Il disait "on va réussir, je ne sais pas comment, mais on va le faire". Les gens adoraient le voir partir dans un raid. Aujourd'hui, c'est impossible de courir comme ça. Et puis il pouvait les répéter, à vouloir rendre le lendemain meilleur que la veille. Il ne se posait pas de questions. Des fois, il ne connaissait même pas le parcours ! Il disait "si je fais Paris-Roubaix, je vais le gagner" alors qu'il n'était pas du tout fait pour ça mais c'est tout lui. Il est admirable parce que quand tout est calculé, lui se lance en disant "pourquoi pas ?".
Que pensez-vous de cette nouvelle génération qui certes attaque mais regarde aussi énormément les capteurs de puissance et ne bougent pas sans avoir eu au préalable une consigne du directeur sportif ?
Selon moi, le cyclisme est, après la Formule 1, le sport qui dépend le plus des évolutions constantes de la technologie. Aujourd'hui, l'effort est plus régulier et constant et la différence se fait dans les 2 derniers kilomètres pour gagner quelques secondes. Cela rend nostalgique car, à mon époque, c'était plus le feeling, avec des coureurs qui pouvaient partir à 25 kilomètres de l'arrivée et les écarts se comptaient en minutes. Maintenant, les coureurs sont orientés dans leurs efforts par les médecins, les préparateurs physiques. C'est plus automatisé et contrôlé.
L'étape du Puy-de-Dôme, avec toute la mythologie qui entoure cette montée, aurait mérité un duel pour la victoire d'étape entre Pogacar et Vingegaard. Est-ce qu'on en attendait trop ?
Le Puy-de-Dôme, c'est mythique mais il s'agit d'une compétition avec beaucoup de stratégie et la façon dont le Tour a été dessiné a fait qu'il y avait déjà des coureurs à 45 minutes au général. Si le Tour s'était terminé le lendemain, l'étape n'aurait pas été la même. Malgré tout, Pogacar a gagné quelques secondes précieuses. Avec Vingegaard, ils font leur course à eux, ils sont à part.
Vous avez fait Paris-Roubaix à 7 reprises et terminé 5 fois. Est-ce qu'à un moment de la course vous vous êtes demandé comment diable vous avez pu passer de Curitiba à l'Enfer du Nord ?
Un jour, Bernard Thévenet qui était directeur sportif chez RMO a dit de moi que j'étais le plus Français des Brésiliens ! Paris-Roubaix, c'est toujours plus simple sur les images. Dans la course, le danger est partout mais j'avais des facilités pour rouler sur les classiques. J'ai aussi fait 9 fois Milan-San Remo par exemple. J'aimais beaucoup cette ambiance. En 1991, on avait la certitude que Marc Madiot pouvait gagner. La veille, il avait dit aux directeurs sportifs de mettre le champagne au frais parce qu'il allait gagner. Il est parti avec cette énergie positive. On la voit toujours quand il parle dans les interviews, même si ça peut parfois paraître agressif. Il est toujours très expressif.
Est-ce qu'il ne trouve pas que ses leaders David Gaudu et Thibaut Pinot manquent justement d'agressivité et d'une certaine forme de caractère comme on pouvait la retrouver chez lui ou Bernard Hinault ?
Hinault imposait sa personnalité. Il y a des courses où il disait qu'un de ses coéquipiers allait gagner aujourd'hui et si ça n'exécutait pas les ordres, il disait que, puisque si c'était comme ça, c'est lui qui gagnerait... et il gagnait ! Si on compare à aujourd'hui, Vingegaard et Pogacar ont une attitude bon enfant. Ils sont respectueux, hyper disciplinés mais il n'y a plus de méchanceté. Quand je suis arrivé dans le peloton, il y avait la culture du grand patron avec Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain. Ça a continué avec Armstrong ensuite. Aujourd'hui, par rapport à la difficulté, il y a une forme de respect, sans oublier qu'il faut faire attention à tout. Par exemple, quand Wout van Aert a jeté son bidon après l'étape de San Sebastián, ça a fait le tour du monde, c'était le grand scandale. Cette génération veut briller, être professionnelle, sans basculer dans l'agressivité, ce qui correspond bien d'ailleurs à tous les enjeux financiers autour d'eux. Il faut avoir cette attitude aussi vis-à-vis de la jeunesse qui les admire. Le comportement du passé, c'était aussi dû aux écarts qui étaient beaucoup plus importants, alors que maintenant, c'est une question de secondes.
Dernière question, impossible d'y échapper : Vingegaard ou Pogacar en jaune à Paris ?
Les choses seront plus lisibles après le Grand Colombier. Pogacar se retrouve isolé plus rapidement mais à partir du moment où ça devient un mano a mano, je crois qu'il est un peu supérieur à Vingegaard... mais après je peux aussi me tromper (rires).