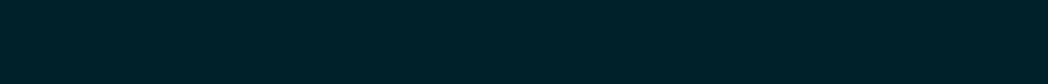Qui aurait pu imaginer, lorsque le Qatar supplantait à la surprise générale États-Unis, Corée du Sud, Japon et Australie pour accueillir le Mondial 2022, dans un climat échauffé par les polémiques sur le micro-Etat gazier, que la FIFA confierait un jour deux éditions de sa compétition reine sans suspense ni débat public ?
Cette double désignation aux airs de formalité, lors d'un Congrès virtuel, rappelle pourtant celle de l'UEFA en octobre 2023 des hôtes des Euro 2028 et 2032 de football, soit les attelages Royaume Uni-Irlande et Italie-Turquie, eux aussi seuls en lice.
De son côté, le Comité international olympique a accordé comme attendu en juillet dernier les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises et ceux de 2034 à Salt Lake City, conséquence de sa nouvelle procédure qui sélectionne les "hôtes préférentiels" plusieurs mois avant le vote final.
Il faut se tourner vers les compétitions féminines, pour l'heure bien moins coûteuses, pour retrouver de la concurrence, autour du Mondial 2027 de football (décroché par le Brésil face au trio Allemagne/Belgique/Pays-Bas), de l'Euro 2025 (quatre dossiers en lice, Suisse élue) et de l'Euro 2029 (cinq dossiers déposés).
"Monstrueux" Mondial à 48
Dans les pays démocratiques, la réticence des populations face à l'impact budgétaire et environnemental des grands événements sportifs explique les échecs d'une cascade de référendums locaux pour accueillir les JO, notamment en Scandinavie, au Canada ou en Suisse.
Mais la course au gigantisme des instances du football, ainsi que "l'énorme complexité des JO en termes juridiques et de sécurisation", réduit aussi le réservoir de pays capables de les accueillir, souligne auprès de l'AFP Pim Verschuuren, enseignant-chercheur à l'Université Rennes-II.
"Un Mondial à 48 équipes", soit 104 rencontres à partir de l'édition 2026 partagée entre États-Unis, Canada et Mexique, contre 64 lors du Mondial qatari de 2022, "c'est monstrueux", résume le spécialiste de géopolitique sportive.
Vingt stades allant de 40 000 à 115 000 places sont d'ailleurs proposés pour accueillir le Mondial 2030 entre Espagne, Portugal et Maroc, sans compter les trois "matches du Centenaire" en Argentine, Uruguay et Paraguay, contre huit enceintes qataries en 2022.
Pour les organisations sportives, ces attributions balisées comportent des avantages : elles évitent les affrontements coûteux et publics entre candidats, et les scandales d'achats de voix qui ont touché à la fois le CIO et la FIFA. "On épargne aux perdants une honte trop visible, qui pourrait les dissuader de candidater à nouveau", explique Raffaele Poli, qui dirige l'Observatoire du Football de Neuchâtel.
Droits humains et environnement
Reste que l'absence de concurrence neutralise tous les critères environnementaux ou sociaux venus gonfler depuis dix ans les procédures de candidature, alors même que ces sujets préoccupent de plus en plus.
La FIFA a certes rendu fin novembre son évaluation des candidatures 2030 et 2034, jugeant que les engagements de l'Arabie saoudite en matière de droits humains supposeraient "un effort significatif en temps et en énergie" d'ici la compétition. Mais cette publication n'a "aucun poids décisionnel" quand il n'y a personne d'autre en lice, relève Raffaele Poli.
Plus largement, pour des événements au rayonnement planétaire ayant un impact direct sur des dizaines de milliers de personnes et engageant les finances publiques, "les marges de manœuvre sont réduites pour avoir un débat public", souligne Pim Verschuuren.
Amnesty International et l'organisation Sports and Rights Alliance ont bien tenté de réclamer la suspension du processus de candidature pour 2034, le temps d'obtenir des garanties sur le sort des travailleurs migrants mobilisés en Arabie saoudite, ainsi que sur l'accueil sans discrimination des supporteurs.
Mais la fenêtre de tir pour en discuter risque de vite se refermer, d'autant que le choix d'un vote commun pour 2030 et 2034 "réduit aussi la possibilité pour les fédérations qui le souhaiteraient" de faire entendre leurs éventuelles réticences sur le dossier saoudien, observe encore M. Verschuuren.